L’administration numérique est-elle vraiment plus accessible. C’est la promesse de la digitalisation des démarches administratives. Pourtant les études démontrent que la population préfère toujours avoir un fonctionnaire pour l’assister. Mais dans le même temps, le débat budgétaire et le discours politique est en faveur d’une baisse du nombre de fonctionnaires.

La galère administrative : le nouveau mal français ? 4 chiffres chocs qui montrent que c’est l’affaire de tous
Qui n’a jamais soupiré face à un formulaire à remplir ou à une démarche administrative à accomplir ? Ce sentiment, souvent frustrant et solitaire, est devenu une expérience universelle. Mais au-delà de l’anecdote, une nouvelle enquête du Défenseur des droits vient mettre des chiffres précis sur ce ressenti collectif.
Publiée en octobre 2025, cette étude agit comme une évaluation grandeur nature des vastes chantiers de modernisation des services publics, notamment la dématérialisation promise par des programmes comme « Action publique 2022 ». Les constats sont aussi surprenants qu’alarmants.
Cet article décrypte les quatre points les plus marquants et contre-intuitifs de cette enquête qui nous concerne tous.
La dématérialisation des procédures facile-t-elle la vie
L’enquête menée par le Défenseur des droits montre que, bien que la dématérialisation puisse représenter un progrès pour certains, elle est loin de faciliter les démarches pour l’ensemble de la population. Ce que montre le sondage c’est que la dématérialisation est même liée à une augmentation notable des difficultés générales.
Voici une analyse détaillée basée sur les résultats de l’enquête :
La Dématérialisation comme Source de Difficultés
L’enquête s’est spécifiquement penchée sur le rôle du numérique afin d’évaluer les effets de la dématérialisation sur l’accessibilité des services publics. Il en ressort que la dématérialisation, lorsqu’elle est mise en œuvre trop rapidement et insuffisamment accompagnée, vient confirmer les difficultés.
Constant : Autonomie réduite en ligne : Une part non négligeable de la population n’arrive pas à effectuer ses démarches administratives en ligne seule.
- Moins d’une personne sur deux (49%) parvient à réaliser seule ses démarches administratives en ligne.
- 36% des répondants déclarent avoir besoin d’une aide ponctuelle.
- 8% n’y arrivent pas seuls et ont besoin d’être accompagnés.
- 7% évitent les démarches en ligne par choix personnel. (ceux qui veulent des humains)
Difficultés pour tous les âges : Les difficultés liées aux démarches en ligne touchent autant les plus jeunes que les plus âgés. Par exemple, 51% des 18-34 ans et 53% des 55-79 ans déclarent rencontrer des difficultés. Surement pas pour les même raisons. Les premiers car ils ne comprennent pas la démarché, les seconds car ils ne sont pas familiers avec les formulaires en ligne.
Augmentation des difficultés générales : La dématérialisation croissante des services publics est liée à un élargissement du nombre et des profils des usagers en difficulté pour réaliser leurs démarches administratives.
- En 2024, 61% des usagers rencontrent des difficultés (ponctuelles ou régulières) pour réaliser leurs démarches administratives, contre 39% en 2016.
- Cette hausse est significative y compris pour les populations considérées comme favorisées, telles que les cadres ou professions intermédiaires (+86 %) ou les diplômés de master et plus (+75 %). Il s’agit ici d’une hause par d’une part de cette population.
Conséquences sur l’accès aux droits : La complexité des démarches est le motif principal de renoncement à un droit (dans 70% des cas). La conclusion est bien que la société est complexe. En ligne ou pas les démarches nécessitent du conseil et assistance. Soit on fait appels à un expert (avocat, expert comptable notaire…) avec un cout associé. soit on veut des fonctionnaires pour aider mais il faut accepter des impôts et des effectifs.
Le fait que les démarches soient réalisables uniquement en ligne et le manque d’accès à un ordinateur ou à internet ont été la raison du renoncement pour 7% des personnes concernées.
Les Ambivalences : Facilitation pour certains, Obstacle pour d’autres
La dématérialisation peut avoir des effets contradictoires.
Simplification potentielle pour les usagers aguerris : Pour les personnes à l’aise avec le numérique, la dématérialisation simplifie la résolution de problèmes avec les services publics (possibilité de réaliser les démarches à distance, de se renseigner plus rapidement en ligne, transmission de documents par voie numérique, etc.).
D’ailleurs, l’enquête observe une baisse de la proportion de personnes déclarant avoir rencontré des problèmes dans la résolution d’un problème avec un service public (passant de 54% en 2016 à 42% en 2024). Cette facilitation potentielle dépend fortement de la capacité à rechercher l’information en ligne.
Le maintien du contact humain comme facteur d’efficacité : Malgré la tendance au “tout numérique”, le contact humain reste l’outil privilégié par les usagers en cas de problème, et il est jugé plus efficace.
- Le principal problème rencontré est la difficulté à contacter quelqu’un pour obtenir des informations ou un rendez-vous (citée dans 72% des cas), ce qui est presque deux fois plus qu’en 2016 et concorde avec la dématérialisation des administrations qui ne prévoient pas toujours de canaux alternatifs. C’est normal, beaucoup de service en ligne ne prévoient pas d’alternatives humaines.
- En cas de problème, les contacts physiques ou téléphoniques sont plus fructueux que les démarches à distance ou dématérialisées. Le succès est de 72% pour ceux qui se sont rendus sur place, et de 67% pour ceux qui ont appelé, contre seulement 56% pour ceux qui ont envoyé un courrier.
Recommandations en faveur d’un accès universel
Face à ces constats, le Défenseur des droits insiste sur l’impératif de garantir un accès « omnicanal » aux services publics.
Les recommandations incluent notamment de :
- Renforcer les procédures alternatives aux démarches dématérialisées, notamment l’accueil au guichet et l’accueil téléphonique, pour permettre à l’usager de choisir le mode de communication le plus approprié à sa situation. C’est facile de la demander. La mise ne place d’un service numérique c’est un cout qui doit s’amortir en remplaçant le cout humain antérieur. Si on cumule les deux couts. c’est l’usager qui paie.
- Simplifier les interfaces numériques et veiller à ce que l’information soit claire, compréhensible et ergonomiquement adaptée à tous (par exemple en utilisant le langage « facile à lire et à comprendre » – FALC). On peut aussi demander que les lois soient plus simples que l’on demande moins de données.
- Renforcer l’accompagnement numérique des usagers qui rencontrent des difficultés spécifiques face à l’administration numérique.
La galère administrative n’est plus réservée aux autres : elle est devenue l’affaire de tous.
Le premier constat choc de l’enquête est l’explosion du nombre de personnes rencontrant des difficultés administratives. En 2024, 61 % des sondés déclarent rencontrer des difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou régulières, contre seulement 39 % en 2016.
Ce qui rend cette évolution particulièrement surprenante, c’est qu’elle touche absolument toutes les catégories de la population, y compris celles que l’on pensait à l’abri. Les chiffres sont sans appel : le nombre de personnes en difficulté a augmenté de +86 % chez les cadres et professions intermédiaires, et de +75 % chez les diplômés de niveau master et plus.
Ce chiffre suggère que la complexité n’est plus un symptôme d’inégalité sociale mais est devenue une caractéristique systémique de l’administration elle-même.
Cette augmentation généralisée contribue paradoxalement à réduire les écarts entre les groupes sociaux, non pas par le haut, mais en universalisant la difficulté. La complexité administrative n’est plus un problème marginal affectant quelques-uns ; c’est devenu un phénomène de société.
Cette généralisation s’explique en grande partie par une transformation majeure de l’action publique : la dématérialisation, dont les effets se font sentir y compris chez ceux que l’on croyait immunisés.
Le mythe du « natif du numérique » : les jeunes aussi peinent avec les démarches en ligne.
L’un des enseignements les plus contre-intuitifs de l’étude est que les difficultés avec le numérique ne sont pas qu’une question de génération. On imagine souvent les jeunes, agiles avec leurs smartphones, naviguer sans effort sur les plateformes administratives. La réalité est bien différente.
Moins d’une personne sur deux (49 %) parvient à faire ses démarches en ligne sans aide. Plus frappant encore, les jeunes de 18-34 ans sont presque aussi nombreux (51 %) à rencontrer des difficultés en ligne que les 55-79 ans (53 %).
Ce constat remet en cause le postulat au cœur de nombreuses réformes : l’idée qu’une simple transition numérique suffirait à moderniser l’accès aux services publics. Il brise le mythe du “natif du numérique” en montrant que la maîtrise des outils du quotidien ne se traduit pas par une aisance face à la logique propre des procédures dématérialisées.
Cette difficulté, qui transcende les générations, explique pourquoi, face à un blocage, le réflexe des usagers n’est pas de persister en ligne, mais de chercher une solution humaine.
Le renoncement aux droits : la conséquence la plus grave de la complexité.
Lorsque la complexité est généralisée, que les obstacles numériques sont là et qu’il est impossible de joindre un interlocuteur, la conséquence la plus grave se matérialise : le renoncement pur et simple à ses droits.
Près d’un quart des usagers (23 %) déclarent avoir déjà renoncé à un droit (une allocation, une prestation, un statut) auquel ils pouvaient prétendre. La raison principale invoquée est la “complexité des démarches”, citée dans 70 % des cas. Mais l’enquête révèle des liens encore plus sombres.
L’échec à résoudre un problème est un puissant catalyseur : 48 % des personnes ayant essuyé un échec après une tentative de contact ont renoncé à un droit, contre 29 % de celles ayant vu leur problème résolu.
Pour conclure
L’enquête du Défenseur des droits dresse un portrait sans concession : les difficultés administratives se sont généralisées, la fracture numérique touche aussi les jeunes, le contact humain reste indispensable et, surtout, la complexité pousse au renoncement. Ces constats interrogent directement la direction prise par la modernisation de nos services publics,
Moderniser le service public ne peut pas se limiter à des mesures d’économie budgétaire ou de rationalisation de l’organisation, au risque de creuser des fractures entre l’administration et les personnes. La conséquence de ces fractures est connue : un ressentiment à l’égard des institutions, qui mine de l’intérieur la confiance qui fonde notre pacte social.
L’enquête agit donc comme un miroir, renvoyant aux décideurs une image de la modernisation où l’optimisation des processus semble primer sur la mission de service. Alors que les services publics se numérisent pour gagner en efficacité, ne sommes-nous pas en train de perdre le sens même du mot “service” ?
Par régis BAUDOUIN
Sources
Enquete sur l’accès aux droits et relations des usagers avec l’admnistration











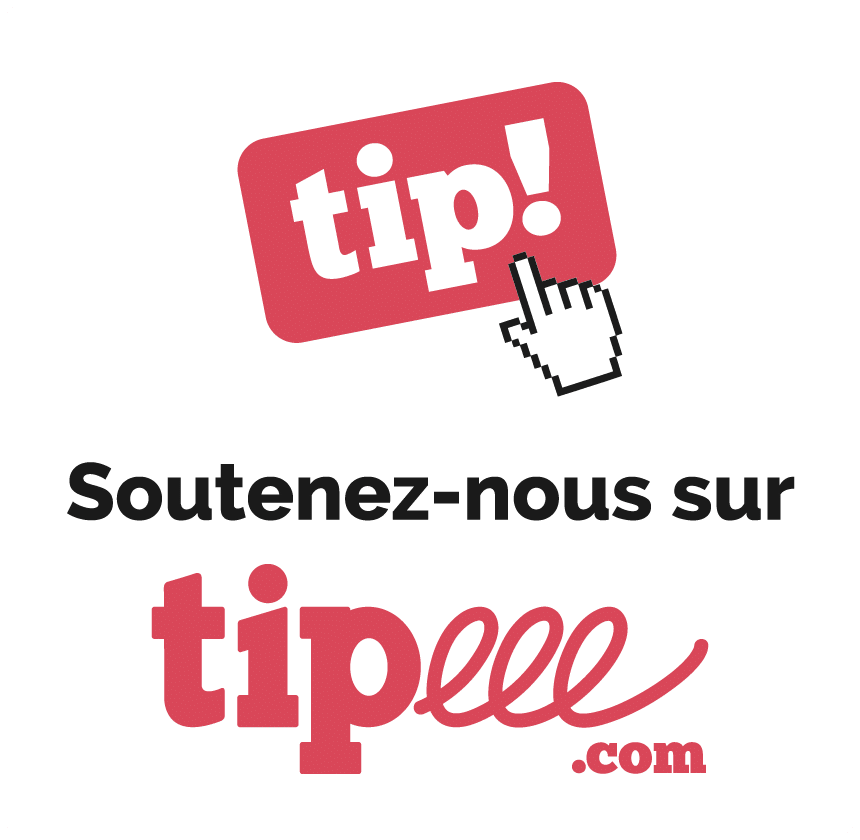
Ajouter commentaire